Du continuum entre oralités et littératies à l’école chez les élèves de 5-6 ans
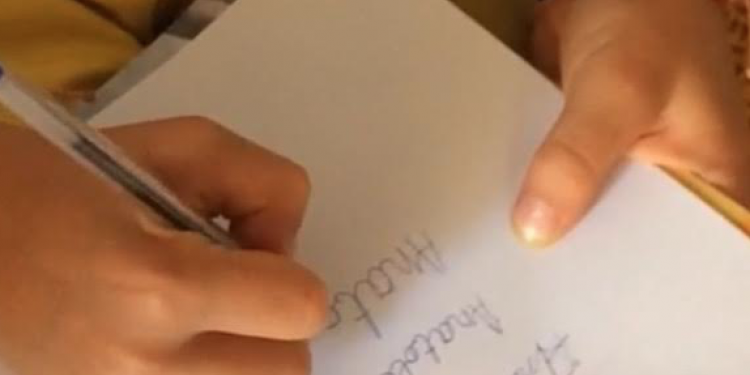
Autrice
Marceline Laparra
Date de publication
2021
Permettez-moi pour commencer d’évoquer brièvement le rôle décisif que Jean-Marie Privat a eu à au moins trois reprises dans mon cheminement intellectuel. Tout d’abord, en compagnie de Marie-Christine Vinson, il m’a aidé à approfondir ma réflexion sur les politiques éducatives en Z.E.P1Zones d’Éducation Prioritaires. à travers les notions de médiations littéraires et culturelles (Privat et Vinson, 1999; Privat, 2006). Puis, à la lumière de sa lecture ethnocritique de Madame Bovary (Privat, 1994), j’ai revisité des textes littéraires qui depuis le début de mes études n’avaient cessé de m’accompagner comme ceux de Victor Hugo (Laparra, 2011 et 2013). Enfin il m’a permis de renouveler mon observation des stratégies développées par les élèves de grande section de maternelle. C’est sur ce dernier point que je vais maintenant m’attarder.
***
Lors de séminaires de notre centre de recherches à l’université de Lorraine, Jean-Marie Privat a très fortement questionné le logocentrisme des linguistes structuralistes. Il m’apprit alors à m’intéresser à l’oralité et non plus seulement à l’oral, ce que je faisais depuis ma thèse (Laparra, 1982). Puis, nous avons eu la chance – grâce à lui – de pouvoir avoir des échanges féconds avec Jack Goody lors de plusieurs rencontres mémorables à Metz. Mais notre prestigieux collègue fit toujours preuve dans ses travaux d’un insistant logocentrisme (Privat, 2019) qui nous a conduit de notre côté à distinguer la littératie linguistique (ou littératie restreinte)2On parle de littératie non linguistique dans les sociétés alphabétisées quand existe une organisation linéaire et géométrique d’un espace matériel ou graphique. de la littératie non linguistique (ou littératie élargie). C’est ainsi que nous avons décidé d’étudier le fonctionnement de la littératie non linguistique dans certaines institutions contemporaines comme l’école ou… les piscines (Privat, 2010). Nous nous démarquions ainsi des études littératiennes anglo-saxonnes (Langage et société, no 133).
Ce double décentrage de l’oral vers l’oralité et de la littératie linguistique vers la littératie non linguistique m’a permis de m’affranchir du logocentrisme qui était le mien pour regarder prioritairement le rôle du corps et des objets liés à la manipulation de l’écrit à l’école lors des premiers apprentissages. Ce double décentrement impliquait désormais de penser la littératie avec l’oralité et l’oralité avec la littératie.
***
Parallèlement, j’ai conduit pendant deux années avec une collègue didacticienne des mathématiques – Claire Margolinas – l’observation de deux classes, une grande section de maternelle puis le cours préparatoire où sont entrés la majorité des élèves de cette grande section. Nous y avons alors suivi l’évolution des pratiques d’une dizaine d’élèves de milieu très populaire dans des activités tournant autour de l’écrit ou autour de la numération. Nous avons analysé ensemble des activités relevant de ces deux domaines. Cette coopération active nous a imposé de réfléchir l’une et l’autre – ne serait-ce que temporairement – hors des cadres de pensée habituels à nos deux didactiques. Au décentrage que les réflexions de Jean-Marie Privat m’avaient conduit à faire s’est donc ajouté le décentrage opéré dans le travail effectué avec C. Margolinas. J’y ai appris notamment à comparer la manière dont les élèves manipulaient les objets de la classe et ces objets de l’écrit que les enseignants appellent des « étiquettes ». J’y ai appris également à considérer les schémas comme des écritures en quelque façon (Laparra et Margolinas, 2009).
C’est le résultat de ces observations que je vais essayer de résumer brièvement maintenant en tentant de décrire comment s’interpénètrent lors des premiers apprentissages les régimes de l’oralité et ceux de la littératie.
***
Étudier les régimes d’oralité impose de décrire l’action de l’école sur le corps des élèves. On peut tout d’abord se demander si ce qu’en dit M. Foucault dans le chapitre intitulé « Les corps dociles » de Surveiller et punir (1973) est toujours d’actualité. Foucault – en donnant d’ailleurs plus de place au modèle militaire qu’au modèle clérical – décrit l’école ancienne comme un lieu où le corps des élèves est soumis à une domestication, se résumant en quelque sorte à l’apprentissage de « l’exercice ». Après lui, M. Crubellier (1979) par exemple, utilise des termes plus neutres et parle à propos des collèges et des lycées d’« éducation des corps » faite sur un mode militaire et à des fins hygiénistes. Toutefois, à propos de la « discipline », il pose lui aussi la question : « couvent, caserne, prison? » En toute hypothèse, les ressources de l’oralité et celles de la littératie se combinent pour réussir ce dressage. Pourtant Foucault ne distingue pas ces ressources les unes des autres. Il les ignore ou les méconnaît d’une manière générale.
L’école moderne quant à elle semble avoir renoncé à nombre de ces pratiques comme si elle était désormais moins soucieuse de créer des corps dociles en pratique que de faire des élèves des êtres de papier. Ces êtres de papier et pour le papier à qui elle ne laisse guère le loisir de se servir des connaissances qu’ils ont pu acquérir par corps à l’école et en dehors d’elle. Les corps sont ainsi sans doute moins dociles mais ils n’en sont pas plus légitimes. Or les élèves semblent résister plus ou moins fortement à une telle entreprise, inventant un bricolage permanent entre les connaissances par corps de l’oralité et les connaissances de la littératie non linguistique, bricolage que les enseignants peinent à prendre en compte.
Les élèves, corps dociles ou corps indociles?
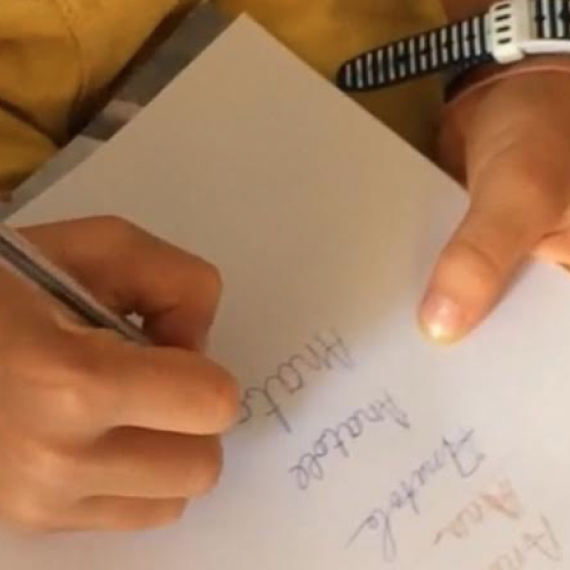
L’école maternelle parait avoir suivi ce processus de civilisation à l’occidentale où les corps sont tenus à distance, à rebours des cultures orales traditionnelles. Les châtiments corporels sont ainsi rigoureusement interdits tout comme les punitions humiliantes, les injures, les insultes et les remarques dévalorisantes sur le comportement ou l’attitude physique des élèves. L’organisation littératienne de l’espace scolaire réduit encore la mobilité des corps qui se meuvent, surtout quand ils se mettent en rang et se déplacent en colonne, en entrant ou sortant de la salle de classe. Le maître quant à lui n’a que rarement une position haute, en surplomb magistral depuis son bureau. Il n’a à sa disposition pour éduquer les corps que le pouvoir d’interpellation et la régulation (qui peut parfois être extrêmement forte) des tours de parole. Il a aussi la capacité de régler le volume de la voix, la sienne et celle de ses élèves. L’action sur le corps des élèves se réduit ainsi à une action sur les paroles et sur les voix.
À l’école primaire cette fois, les élèves doivent intérioriser quelques contraintes corporelles nouvelles. Ils sont assignés à une place et ne bougent plus librement. Le maître peut occuper une position haute (debout par exemple) et eux une position basse (assis). Pour le reste leurs corps évoluent dans un cadre très proche de celui de la maternelle. Mais surtout les moyens littératiens de coercition dont se servait l’école du passé – rang, colonnes – semblent eux aussi de moins en moins utilisés. On se déplace certes dans des couloirs rectilignes et les élèves se déplacent toujours en rangs; mais ils sont loin de respecter des lignes rigoureuses… On est alors censé se taire – mais on papote à voix basse; on rit aussi. La discipline est loin d’être celle d’un camp militaire ou d’un univers religieux! Enfin, ce que Foucault considère comme un exercice emblématique de cette domestication des corps scolaires – l’apprentissage manuel rigoureux du graphisme – paraît se relâcher inexorablement, au grand désespoir des tenants du passé, alors qu’il avait résisté jusqu’au dernier tiers du siècle précédent. Foucault voit dans cet apprentissage de l’engendrement manuel des lettres – plus qu’une simple technique du corps – un véritable dressage (posture du dos, du poignet, des doigts). Pour lui la tenue du fusil et celle du porte-plume relèvent dans leur principe et dans leur pratique de la même logique. Il met au second plan le fait que des raisons purement matérielles rendaient jadis obligatoire l’incorporation de ces attitudes qui seules permettaient d’exercer la pression minimale sur un papier de mauvaise qualité pour pouvoir y tracer des lettres. Les encres étaient d’ailleurs à séchage lent et la pointe des instruments ne glissait que difficilement sur le papier d’alors. Or des raisons elles aussi matérielles sont intervenues pour rendre cet apprentissage inutile – du moins apparemment – sur le plan de l’efficacité du geste : invention des roulements à bille, amélioration de la surface des papiers et usages d’encres à séchage presque immédiat. Les élèves écrivent par ailleurs très souvent sur des feuilles libres non margées et non lignées.
***
Diverses causes ont donc changé très profondément la gestion des corps lors des premiers apprentissages scolaires : le statut de l’enfant s’est modifié dans la société; des modèles comme celui du jardin d’enfants se sont diffusés à l’école (l’apprentissage par le jeu occupe encore une grande place en grande section de maternelle) et des évolutions technologiques concernant l’acte graphique ont eu lieu. Enfin, les objectifs fixés à l’école se sont transformés : moins d’attention à l’hygiène primaire des corps (habitude censée être acquise à la maison) et beaucoup plus d’acculturation à la culture écrite. Certaines pratiques semblent donc régresser. Mais ces évolutions ne doivent pas masquer un phénomène massif : les élèves doivent bon gré mal gré incorporer un habitus littératien en dehors de toute pratique effective de lecture; ils ne savent pas encore lire. Aussi peut-on dire que l’école n’est plus habitée par des corps dociles mais par des êtres de papier.
Les élèves, êtres de papier
À l’école, l’enfant se construit langagièrement comme une personne et ce au travers de son prénom. Il est désigné et identifié oralement par son prénom. Mais dès l’âge de quatre ans il apprend en fait à avoir un nom de papier. Il sait reconnaître le carton sur lequel est écrit une série de lettres dont on lui a dit qu’il était son « étiquette ». Il ne sait pas la lire mais il sait à la demande placer son « étiquette-prénom » dans une ligne ou dans une colonne, à côté ou en dessous de celles de ses camarades, comme il le fait quand il place son bonnet sur le bon porte-manteau. En mettant cette étiquette à une place assignée dans un espace organisé par un quadrillage littératien il apprend à s’insérer dans un univers très contraint. De membre d’une société enfantine il devient un élément d’un ensemble sans chair. Par exemple, pour dire qui est présent ou absent dans la classe, l’élève pourrait par un simple regard circulaire donner très rapidement la réponse juste. Mais, pour fournir la réponse attendue, il doit apprendre à procéder à l’examen de la liste constituée par les « étiquettes » que les élèves ont apposées au mur, au fur et à mesure de leur arrivée en classe. À son prénom oral qui le désigne et l’identifie s’ajoute un carton qu’il sait être le sien et qui sert à exercer une forme de contrôle sur sa présence. En somme, il a un prénom et un nom de papier.
Alors même qu’il ne sait pas encore se situer dans le temps, il est mis en présence d’écritures qui renvoient à l’organisation littératienne du temps. On lui fait manipuler presque journellement la liste des étiquettes des jours de la semaine et celle des mois de l’année. Ce faisant, il doit arriver à « écrire » au tableau la date du jour. Quand un élève se voit distribuer une feuille blanche ou une fiche, il doit toujours – quelle que soit l’activité proposée – commencer par y reproduire, souvent très péniblement, son nom et la date du jour. Un même élève peut avoir à le faire plusieurs fois par jour.
Ces apprentissages sont d’autant plus étonnants qu’ils ne sont le plus souvent accompagnés d’aucune justification adaptée à la compréhension véritable de jeunes élèves. Il serait d’ailleurs difficile de le faire pour certains de ces apprentissages. En effet, à quoi peut bien rimer pour un enfant de cinq ans une liste de présents quand ladite liste n’a en fait d’utilité que pour l’enseignant? On pourrait expliquer à quoi servent d’autres pratiques, mais on constate que ce n’est pratiquement jamais le cas. On ne leur montre pas – par exemple – que mettre son nom sur une feuille permet de la retrouver parmi quantité d’autres feuilles ou qu’écrire sur une feuille la date du jour permet de la classer plus commodément. Tout ceci démontre que ces apprentissages ne sont pas là pour construire des connaissances littératiennes, mais pour faire passer l’enfant d’un monde « sauvage » ou disons plutôt « innocent » à un monde où règne un ordre de papier. Et dans cet univers de papier et non d’écrit, les élèves s’engluent dans la matérialité des supports sur lesquels figurent des suites de lettres. Ils peuvent les manipuler avec des connaissances de la littératie non linguistique (ils savent les ordonner en ligne et en colonne). Mais, s’ils apprennent à la demande à les organiser de diverses manières, ces étiquettes sont avant tout pour eux un matériau avec lequel ils effectuent de nombreuses opérations : elles sont découpées avec soin, collées, décollées, recollées, mises bord à bord, coloriées. Ils font tout ce petit travail en général avec grand plaisir. Reconstituer une liste en remettant dans l’ordre fourni par un modèle un tas d’étiquettes n’est en fait pas différent de faire un puzzle. Quand ils voient que leur étiquette n’est pas en tête de la liste des étiquettes des présents affichées sur le mur de la classe, ils essayent souvent discrètement de l’y placer, exactement comme il leur arrive de se bousculer pour être les premiers dans les rangs quand ils sortent de la classe.
Il est normal que de jeunes élèves résistent à quitter le monde de l’oralité où s’est construite leur première socialisation pour entrer sans l’aide des autres dans cet univers de papier. Mais rapidement ils entreprennent tous avec plus ou moins de réussite de l’investir en bricolant et combinant entre elles des ressources de l’oralité et des ressources de la littératie.
Le continuum oralité-littératie: entre belligérance et bricolage
- Résistance à l’entrée dans la littératie
L’un des premiers effets de la volonté de confronter les jeunes élèves à l’écrit est de leur demander d’effectuer des tâches non pas en groupe mais chacun de leur côté. L’organisation dominante en maternelle ne doit pas tromper l’observateur. Si la classe est bien souvent divisée en groupes appelés « ateliers », et si chaque groupe doit réaliser la même tâche, le plus souvent à l’intérieur d’un groupe les élèves travaillent seuls, en remplissant par exemple une fiche. Une telle situation est profondément déstabilisante pour beaucoup d’élèves. Ils vont alors essayer de reconstituer la chaleur du groupe en se parlant et en se touchant. Par exemple, quand ils doivent mettre en ordre des étiquettes prédécoupées sur une feuille. Ils découpent, disposent et collent leurs étiquettes chacun isolément, mais ils le font tout en se racontant des histoires, en se donnant des petits coups ou en se faisant des grimaces. Ils reproduisent sans le savoir des pratiques observées dans des ateliers d’adultes où chacun effectue la tâche qui lui est impartie tout en devisant avec les autres.
À l’opposé, autrefois, l’école demandait aux élèves de reproduire tous ensemble – « en chœur » et à pleine voix – la même phrase, la même poésie ou la même table d’addition. Elle le faisait à la fois pour des raisons matérielles et pour favoriser des apprentissages par corps; mais elle le faisait surtout pour domestiquer les corps, les élèves ne faisant alors plus qu’un. Cette pédagogie n’empêchait pas les élèves de s’y adonner avec ardeur et plaisir : fondre sa voix dans celles des autres permet en effet de se sentir pleinement membre d’un groupe. Quand l’école contemporaine reprend ces pratiques, c’est d’ailleurs à la satisfaction des élèves…
Ce type de résistance à l’entrée dans l’écrit vise à maintenir une dimension collective dans une tâche individuelle. Il est en général bien toléré par les enseignants car il ne semble perturber qu’à la marge le travail de chacun. Mais il existe d’autres manifestations de résistance. Elles ont trouvé refuge dans la cour de récréation et à l’origine ces manifestations s’opposaient à l’embrigadement scolaire : bousculades collectives, brimades, injures, insultes, etc. Les élèves tentent souvent de les importer soit dans les couloirs soit jusque dans la classe, entre chacune des activités scolaires. Ils utilisent donc des ressources de l’oralité à la fois pour s’émanciper de l’emprise que l’école exerce sur les corps et pour ne pas devenir ou du moins être réduits à des êtres de papier. Dans d’autres cas la résistance devient individuelle et l’élève ruse en manipulant certains objets de l’écrit pour retarder le moment de pénétrer dans ce monde de papier.
Certains élèves éprouvent en effet le besoin de ménager une transition entre l’oral et l’écrit avant de s’atteler à la tâche prescrite sur une fiche. Pendant que l’enseignant explique oralement les consignes, par exemple, quelques élèves – repérés comme étant en difficulté devant l’écrit – s’affairent autour de leur cartable, en sortent divers objets (règles, compas, gommes, effaceurs, équerres, etc.) ou les y recherchent en vain – alors même qu’ils ne leur sont d’aucune utilité pour effectuer la tâche demandée. L’enseignant leur intime souvent en pure perte de cesser leurs recherches. Loin de le faire, beaucoup d’élèves s’obstinent et importunent des camarades qui, eux, sont déjà en train de faire ce qui leur était demandé. Cette activité les empêche d’écouter les consignes et ils n’ont d’autres ressources que de demander ce qu’il convient de faire à leur voisin immédiat. Cette scène est observable régulièrement dans les grandes sections de maternelle. Elle conforte l’observateur adulte dans l’idée que ces élèves sont agités et incapables d’attention. Ces explications de type psychopédagogique lui interdisent de voir dans ces conduites le signe d’une désynchronisation dans le passage de l’oralité à la littératie. L’élève, lui, aménage une phase intermédiaire d’activité solitaire entre l’oralité et la littératie : il manipule des objets de l’écrit sans raison apparente – comme s’il cherchait à apprivoiser l’activité littératienne solitaire à venir. Il est en cela à l’opposé de l’élève qui se jette de manière tout aussi problématique dans la tâche écrite (et qui témoigne lui aussi d’un déphasage), alors même que l’enseignant est encore en train de donner ses consignes. Tout se passe comme si les objets de l’écrit fonctionnaient pour le premier comme des moyens de sécurisation. De telles pratiques d’assurance se manifestent encore chez beaucoup de scripteurs experts qui disposent avant d’écrire devant eux toujours à la même place divers objets appartenant au monde de l’écrit (règle, trousse, effaceur, colle, etc.).
- Bricolage
Certains élèves ressentent donc le besoin d’une phase de transition entre le confort du groupe et la solitude imposée par l’écrit. Mais, quand enfin ils entrent dans l’univers de la littératie, ils peuvent y maintenir des conduites de l’oralité, comme antérieurement ils pouvaient avoir déjà introduit dans l’univers de l’oralité des connaissances de la littératie non linguistique. On assiste alors à une forme de bricolage qui combine les connaissances de l’oralité et celles de la littératie. Car tous les élèves, même ceux qui sont les plus éloignés dans l’univers familial de la culture écrite, ont développé certaines connaissances de la littératie. Ils vivent en effet et de toute façon dans un monde fortement littératié. Ainsi, à titre d’exemple, dans les magasins les produits sont méthodiquement rangés sur des linéaires et la déambulation s’y effectue dans un espace quadrillé sinon orienté. L’agencement du réfrigérateur familial obéit lui aussi aux mêmes règles. Les enfants se font souvent rappeler à l’ordre quand ils perturbent ce mode de rangement rationnel voire géométrique. De même, beaucoup de jeux font appel à des connaissances littératiennes : tout élève qui fait un puzzle sait qu’il faut commencer par sélectionner les pièces qui ont un bord rectiligne. Ces connaissances encore très fragmentaires vont alors être mélangées à des connaissances de l’oralité.
***
Prenons comme exemple plus précis une activité souvent observée en grande section de maternelle avec des variantes d’une classe à une autre : on place chaque élève devant un carton comportant douze cases disposées en quadrillage (il s’agit souvent d’une boîte d’œufs). On a déposé dans cinq ou six d’entre elles une petite balle en mousse. L’élève doit aller chercher dans une corbeille placée à une certaine distance les balles dont il a besoin pour que toutes les cases soient remplies. Pour réussir la tâche il doit être capable de procéder à l’énumération des cases vides, de mémoriser le résultat et de prendre le nombre de balles correspondant dans la corbeille. Il doit les compter au fur et à mesure de leur saisie. La tâche se révèle extrêmement discriminante. Or en maternelle tous les élèves savent compter jusqu’à 12. Ce sont donc d’autres connaissances qui entrent enjeu pour expliquer les réussites et les échecs. Les élèves utilisent des stratégies très différentes et se servent différemment de connaissances de l’oralité et de connaissances de la littératie pour déterminer le nombre de cases vides. Certains restent dans l’oralité. Ils dénombrent en effet les cases vides en dessinant un parcours hasardeux de l’une à l’autre avec le doigt : ils aboutissent le plus souvent à un résultat faux… D’autres mêlent oralité et littératie : ils parcourent le quadrillage avec le doigt en suivant ou des lignes ou des colonnes. Quand ils rencontrent une case pleine, leur doigt la saute, un peu comme dans le jeu des petits chevaux. D’autres enfin utilisent des connaissances de la littératie : ils déplacent les balles pour les aligner sur une ou deux lignes ou colonnes. Ils n’ont plus qu’à procéder à l’énumération des cases vides qui ont été regroupées en ligne ou en colonne. Ils ne se trompent presque jamais et l’opération est relativement rapide. Dans le premier cas les élèves ne voient pas que les cases du carton sont disposées dans un quadrillage. Dans le deuxième cas les élèves s’appuient bien sur ce quadrillage, mais ils se servent encore d’un doigt pour procéder à l’énumération. Oralité et littératie se mélangent alors fortement. Dans le troisième cas, c’est la littératie qui est dominante.
On pourrait multiplier les exemples de bricolages de ce type, bricolage qui perdure très longtemps, parfois bien au-delà de l’école primaire.
- Cécité de l’école à ces phénomènes
Les enseignants voient bien que les élèves résistent souvent quand ils cherchent à les familiariser avec la culture écrite. Mais ils se trompent sur les raisons qui poussent leurs élèves à avoir une telle attitude. Ils pensent alors que cette culture exige une forme d’attention dont certains seraient incapables pour des motifs psychologiques et parfois, simultanément, ils supposent que la famille serait responsable de cette attitude quand l’enfant vit dans un univers dépourvu d’écrits, au sens strict du terme. De la même manière les bricolages auxquels se livrent leurs élèves sont très souvent source de malentendus. Ceux-ci sont trop fréquemment interprétés négativement, comme ne correspondant pas, par exemple, à la consigne donnée, ou même ils ne sont pas repérés et demeurent invisibles aux yeux des observateurs qui n’ont pas été formés à distinguer ce qui relève de l’oralité et ce qui relève de la littératie. Les enseignants peuvent regarder faire leurs élèves sans voir pour autant ce qu’ils font : les élèves arrivent certes à lire ce qui écrit, mais s’ils effectuent correctement la tâche demandée, la réussite est souvent le fruit d’un bricolage performant. Les enseignants ne sont toutefois pas les seuls dans ce cas! Les meilleurs anthropologues peuvent s’y tromper eux aussi. C’est par exemple, me semble-t-il, le cas de J. Goody (1985 : 51-53) quand il décrit dans La raison graphique comment les LoDagaa s’y prennent pour compter des coquillages (Laparra et Margolinas, 2016). Tout à son souci de comprendre leur système de numération, il ne s’attarde guère sur la manière de constituer les tas de coquillages ou sur leur place respective. En toute hypothèse, la seule lecture du texte de Goody ne permet pas de reconstituer avec précision ce que font réellement les LoDagaa, comment ils s’y prennent.
***
Beaucoup de ces connaissances de l’oralité comme de la littératie non linguistique ne sont pas l’objet d’une scolarisation explicite. Elles ne peuvent de ce fait être stabilisées et décontextualisées pour devenir des savoirs institués susceptibles d’être réinvestis dans d’autres situations que celles dans lesquelles elles ont été mises en jeu. Ces connaissances sont même déniées aux élèves, surtout aux élèves supposés être les plus faibles, qu’il s’agisse de connaissances de l’oralité ou de connaissances de la littératie. Pour prouver aux élèves la supériorité de l’écrit sur l’oral un enseignant peut mettre en doute les capacités orales d’un élève, notamment en matière de mémorisation (Laparra et Margolinas, 2016). Par exemple, après avoir fait voter des élèves et procédé au dépouillement du vote, un enseignant interroge quelque temps après un élève supposé très faible pour qu’il en redonne les résultats. Il montre par son intonation qu’il s’attend à ce que l’élève se trompe. À sa grande surprise l’élève lui fournit les bons résultats, ce qui n’est guère étonnant puisque les nombres à mémoriser sont petits et qu’il y en a peu. L’enseignant demande alors à l’élève s’il est bien sûr de lui et avec l’aide du reste de la classe – ravie de mettre en difficulté un camarade… – il le conduit à douter de ce qu’il vient de dire. Il ne peut donc pas le féliciter pour son excellente mémoire et rate de ce fait l’occasion de lui faire chercher les raisons pour lesquelles il conviendrait néanmoins de consigner par écrit ces résultats.
On pourrait sans difficulté multiplier les exemples de ce type. De la même manière on confronte les élèves à de nombreuses listes écrites sans vérifier que les élèves connaissent les suites orales correspondantes. Presque tous les élèves de grande section de maternelle savent ordonner la collection des étiquettes des jours de la semaine ou celle des mois de l’année. Ils savent désigner et nommer l’étiquette d’un jour par rapport à l’étiquette du jour le précédant ou le suivant. Mais beaucoup trop d’entre eux se révèlent incapables en situation orale de répondre à une question du type « demain on sera quel jour? ».
Apprendre (aussi) par corps
L’école a donc profondément modifié son mode de gestion des corps et a simultanément construit peu à peu un univers de papier dans lequel les élèves doivent vivre au motif de les préparer à « entrer dans l’écrit ». Ces transformations, qui se sont produites sur une cinquantaine d’années, modifient en profondeur les situations dans lesquelles sont placés les jeunes élèves à l’école avant et pendant l’apprentissage de la lecture. Leurs effets sont largement sous-estimés par les différents observateurs. Deux raisons d’ordre très différent expliquent sans doute leur invisibilité. Tout d’abord les outils d’analyse nécessaires à leur repérage renvoient aux concepts d’oralité et de littératie non linguistique qui n’ont pas à ce jour une grande diffusion. Ensuite, ces transformations ne sont pas le résultat de politiques linguistiques ou scolaires délibérées. Nul n’a voulu changer le fonctionnement de la maternelle ou de l’école primaire en la matière. C’est la primarisation progressive de la maternelle sous la pression sociale des classes moyennes (Laparra, 2006) et le souci manifesté par l’institution d’acculturer précocement à l’écrit les enfants de milieu populaire qui ont fait que – à l’insu de tous – les enseignants ont plongé leurs élèves dans un monde où se mêlent inextricablement pratiques de l’oralité et pratiques de la littératie non linguistique. On peut à juste titre parler d’un continuum oralité/littératie (Laparra et Margolinas, 2019).
***
On pourrait penser que l’existence d’un tel continuum est favorable aux élèves de milieu populaire que l’apprentissage de la lecture met souvent en difficulté : il créerait une sorte de sas entre le monde de la petite enfance soumis aux lois de l’oralité et celui de la grande école soumis à l’ordre impératif de la littératie. Or c’est le contraire qui se produit. Les connaissances qui y sont en jeu restent comme invisibles aux yeux de tous (Margolinas et Laparra, 2011) et en conséquence elles ne sont ni décontextualisées à des fins didactiques ni a fortiori instituées (Laparra et Margolinas, 2010). Les élèves et leurs corps se confrontent dès lors comme ils le peuvent, avec plus ou moins de ressources apportées par la famille, à cet univers composite aux règles cachées ou inconnues. La construction de la socialisation scolaire peut s’y trouver gravement perturbée. L’appartenance sereine à une société enfantine est remise en question et ils découvrent souvent qu’il leur faut s’en séparer à leur corps défendant, pour entrer non pas dans l’écrit des Lumières comme l’espère l’institution mais dans un étrange espace de papier. Y coexistent objets du monde et objets de l’écrit régis parfois par les mêmes lois et parfois non. Les connaissances par corps qui relèvent aussi bien de l’oralité que de la littératie y sont réduites à la portion congrue, manifestant de manière emblématique la difficulté qu’a l’école à s’affranchir de son logocentrisme et son indifférence aux apprentissages par corps.
Bibliographie
Crubellier M., L’enfance et la jeunesse dans la société française 1800-1950, Paris, A. Colin, 1979.
Foucault M., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1973.
Goody J., La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Minuit, 1985.
Langage et société, Paris, Maison des sciences de l’homme, no 133, 2010.
Laparra M., « Sélection thématique et cohérence du discours à l’oral », Le français moderne, no 3, juillet 1982, p. 209-236.
Laparra M., « La grande section de maternelle et la raison graphique », Pratiques, no 131-132, 2006, p. 237-249.
Laparra M. et C. Margolinas, « Le schéma : un écrit de savoir? », Pratiques, no 143-144, 2009, p. 51-82.
Laparra M. et C. Margolinas, « Milieu, connaissance, savoir. Des concepts pour l’analyse de situations d’enseignement », Pratiques, no 145-146, 2010, p. 141-160.
Laparra M., « Le pays où “les rats mangent les chats” ou l’histoire de Gavroche et de l’éléphant », Pratiques, no 151-152, 2011, p. 207-225.
Laparra M., « Paris et le peuple “inclassable” dans les Misérables », dans Preiss, N., J.-M. Privat et C.-J. Yon (dir.), Le Peuple parisien au XIXe siècle, entre sciences et fictions, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2013, p. 57-71.
Laparra M. et C. Margolinas, « Les premiers apprentissages scolaires à la loupe. Des liens entre énumération, oralité et littératie », Louvain, De Boeck, 2016.
Margolinas C. et M. Laparra, « Des savoirs transparents dans le travail des professeurs à l’école primaire », dans Rochex J.-Y. et J. Crinon (éd.), La construction des inégalités scolaires, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 19-32.
Margolinas C. et M. Laparra, « Comment se manifeste le continuum oralité / littératie? Étude d’une tâche de classification », Pratiques, no 183-184, 2019.
Privat J.-M. et M.-C. Vinson, « Les intermédiaires de lecture. Théorie et pédagogie des médiations culturelles », Pratiques, no 63, 1989, p. 63-101.
Privat J.-M., Bovary Charivari. Essai d’ethno-critique, Paris, CNRS, 1994.
Privat J.-M., « Un habitus littératien? », Pratiques, no 131-132, 2006, p. 125-130.
Privat J.-M., « Un bain de littératie », ethnographique.org, vol. 20, 2010.
Privat J.-M., « Oralité /Auralité », Pratiques, no 183-184, 2019.
Pour citer
Laparra, Marceline, « Du continuum entre oralités et littératies à l’école chez les élèves de 5-6 ans. Entre belligérance et bricolage », dans V. Cnockaert, M. Scarpa et M.‑C. Vinson (dir.), L’ethnocritique en mouvement. Trente ans de recherches avec Jean‑Marie Privat, « Ethno/livres », 2021, https://ethnocritique.com/du-continuum-entre-oralites-et-litteraties-a-lecole-chez-les-eleves-de-5-6-ans/.
Sommaire
No post found!
